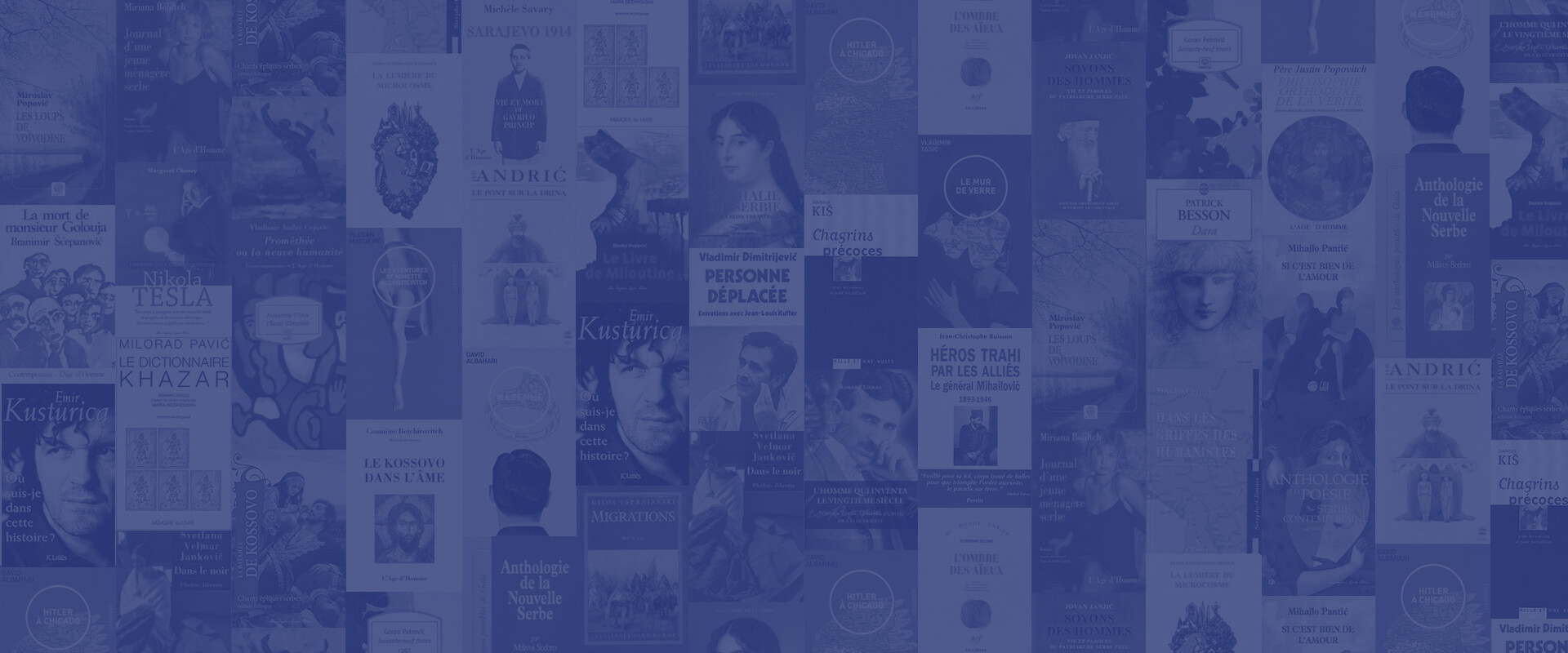Journal d’une jeune ménagère serbe, par S. Despot
|
« Les films n’étaient vraiment qu’une pâle copie, pas même une esquisse de ce que nous vivions. » La Serbie des années 80-90, que nous découvrons à travers ce Journal d’une jeune ménagère serbe, est un pays chaotique, trépidant, tiraillé en tous sens par ses espoirs et ses désillusions.Cette Serbie, durant une dizaine d’années, aura été au cœur de l’actualité. Qui saurait dire, pourtant, comment ce pays a vécu les revirements historiques colossaux dont il a été l’épicentre? La plume évocatrice, proche et comme familière, de Miriana Bobitch, nous livre la chronique de toute une génération. Son héroïne, Andjelka, disant d’elle-même : « je suis tout ce que l’on peut dire sur la Serbie », nous peint les années euphoriques du communisme titiste, où l’on « vivait » en viveurs — aux crochets du monde entier, sans travailler et sans souci du lendemain —, les peurs populaires causées par la récession et les crises nationales, les motifs de son propre engagement en faveur du « nationalisme serbe » et de celui qui, pour le monde entier sauf pour lui-même, en aura été l’incarnation: Slobodan Miloševic. Il faut aujourd’hui bien de l’audace pour rappeler ce qui, à l’époque, était clair pour tous: que cet homme résolu, intelligent et jeune avait, à lui seul, sonné le réveil d’un peuple bercé plus qu’aucun autre par les illusions de la « fraternité » communiste. Qu’il avait balayé de la scène une caste de satrapes dressés comme des otaries à applaudir tout ce qui pouvait nuire aux intérêts de la nation dont ils étaient issus — et qui du reste se dresseront comme un seul homme, dès octobre 2000, pour aider leurs nouveaux maîtres occidentaux à démanteler ce qui restait de leur pays. Que le bolide Miloševic, dans les années 80, n’était pas seulement mû par une éruption de nationalisme mais encore par une aspiration honorable à vivre en citoyens d’un Etat souverain plutôt qu’en serfs d’un système féodal et corrompu.Mais la grande histoire, en l’occurrence, n’est que le cadre où se loge et se débat la petite, celle qui est la vérité des gens et des romanciers. Au fil de la confession d’Andjelka défilent des personnages paradoxaux, détestables et attachants tout à la fois, depuis ses parents et jusqu’aux personnalités publiques, tous représentatifs d’une facette de la complexe mentalité serbe. La mère de l’héroïne, aussi chargée d’amour pour les siens que de haine pour son propre peuple, est un des plus insolites portraits féminins de la littérature européenne moderne.On découvre, en lisant Miriana Bobitch-Moïssilovitch, à quoi s’épuise l’énergie vitale de ses compatriotes : à un amour-haine avec leur prochain, à des conflits futiles et profonds tempérés par une immense pitié, le tout s’échouant dans l’indécision et le fatalisme. Au sein de ce peuple condamné au face-à-face avec lui-même, la question de l’identité nationale, d’inexistante quelques années auparavant, devient cruciale ; à cause d’elle, les amitiés se défont, les familles se scindent, le pays entier, tétanisé, attend le salut d’un chef ou d’un parti providentiel. D’apothéoses en dépressions, on y mène une existence en forme d’électrocardiogramme. Retour en puberté d’une société brutalement privée de tous les repères qui, tant bien que mal, balisaient sa vie.Grâce à ce Journal, nous vivons de l’intérieur des événements que d’autres peuples d’Europe ne peuvent seulement concevoir : des années d’embargo et de pénuries épuisantes, des guerres et des catastrophes affrontées avec une étonnante désinvolture, une inflation chiffrée par dizaines de zéros… C’est aussi, surtout, la première œuvre qui dépeigne avec précision et mesure la psychologie des générations élevées en régime totalitaire, et l’enlaidissement des âmes sous le communisme. Car au milieu des caractères hérités et des traits individuels qu’elle sait admirablement croquer, l’auteur dégage aussi cette étrange et universelle torpeur de la volonté, cette confusion morale, qui trahissent infailliblement le conditionnement social légué par la rééducation communiste. Sociologues, psychologues et écrivains de métier sont ici impuissants. Un tel éclairage ne pouvait venir que d’une rescapée. Voici quelques années, en des circonstances très différentes, une autre confession venant de l’intérieur a permis une plongée analogue dans un monde à peine concevable. Fritz Zorn, rejeton dégoûté de la haute bourgeoisie zurichoise, a rédigé son Mars alors qu’il se savait condamné, encore jeune, par le cancer. La maladie, à ses yeux, était le produit même de son milieu décomposé. Ce garçon de bonne famille, promis à une vie de chenille stérile et opulente, avait trouvé la force, avant de mourir, de devenir papillon. Avec la lucidité du mourant, il a percé d’épaisses couches d’hypocrisie, intime et sociale, pour crever au soleil une termitière purulente au milieu d’un jardin enchanté. Andjelka, notre héroïne, frôle elle aussi la mort. Mais la mort, là où elle vit, ne suffit pas à briser le cocon de la chenille. Dans sa génération, en Serbie, les jeunes voyous se jouent de la mort et se donnent rendez-vous « dans les annonces mortuaires ». Face à la corruption, à l’absence de tout avenir, à l’incertitude de la survie quotidienne, le néant est un havre. Andjelka, du reste, finit par trouver des raisons de vivre et de procréer. Autre chose vient ouvrir son « troisième œil ». Le 24 mars 1999, alors que les premiers missiles tombent sur Belgrade, elle assiste, médusée, au monologue de sa marraine, femme aisée, médecin, ayant étudié à l’étranger, acclamant, délirante, le « juste châtiment » qui s’abat sur tout ce qu’elle déteste. Quelle est cette tare du caractère national qui donne aux étrangers, qui la flairent, le droit de considérer les Serbes comme des chiens enragés, comme une vermine universellement coupable ? D’où vient cette haine ? D’où est-ce que sa propre mère, vertueuse, dévouée, hygiénique, austère et roide comme la Justice, puise cette hargne froide et puritaine qui fait d’elle une harpie sifflante sitôt qu’il est question de « Serbie » ? Les mères étant le pilier de tout ordre social, l’on comprend ainsi, tout d’un coup, pourquoi la « cause serbe » n’a jamais pu se défaire d’un certain relent d’indécence, de subversion, voire de marginalité, même sous un régime qui en avait fait son argument premier. Avec son tablier, son maintien réservé et impeccable, son assurance méprisante, voici la Parque des temps modernes, dont le « bon goût », au demeurant tout à fait irrationnel, juge la morale et les destinées de tous. Elle est à la fois une source et un relais de cette bienséance diffuse qui dicte les attitudes et les opinions, qui emplit l’air des cafétérias d’université, des salles de rédaction, des salons bourgeois, de tous les lieux enfin où le papotage et l’intrigue se drapent de moralité. Sous ce régime-là, le « nationalisme » et toutes les idées qui prennent l’homme et le monde pour ce qu’ils sont plutôt que pour ce qu’ils devraient être, sont irrémédiablement condamnés pour crime de lèse-idéalisme et traités, à l’égal de la pornographie, comme des vices et non comme des points de vue. Fendant la vie comme une dame patronesse, cette mère dévouée et sincèrement aimante n’en sera pas moins d’une cruauté inflexible envers les « pécheurs » de son entourage. Face à un père désabusé et absent, cette bonne conscience flamboyante occupe le terrain sans partage. Cristallisant toute l’impossibilité de vivre d’un monde dont chaque pore est obstrué par l’idéologie. Dressée à être sage et à toujours faire comme si de rien n’était, la ménagère serbe égrène en tête de ses chapitres toutes les vertus que l’on attend d’elle. « Je ne bois pas — Je suis très sensible — Je cuisine très bien… ». Mais dès la troisième phrase, le cliché se lézarde, comme toute cette idylle yougoslavo-titiste qui fit croire un temps qu’il suffisait d’être bien élevé, bien pensant et surtout anti-nationaliste serbe — car le nationalisme serbe est le plus dangereux parce que les Serbes sont le peuple majoritaire —, pour que tout aille au mieux dans le meilleur des mondes. (Que le lecteur occidental à qui cela ne rappelle rien referme aussitôt ce livre.) Nous voici dans le vif du sujet. Dans le communisme yougoslave, nous explique Andjelka, tout était permis, sauf de prendre la vie au sérieux. Dans les années 60-70, on dansait le rock and roll, on passait ses étés à la mer, on faisait l’amour partout et avec n’importe qui. On voyageait à l’étranger. On ne travaillait que pour la forme. De quoi faire saliver non seulement les frères d’infortune roumains ou tchèques, mais même les contemporains de l’Ouest, à qui le système en place offrait tout de même moins d’occasions de farniente. Mais cette vie de cocagne sur les milliards américains ne pouvait survivre au funambule qui en avait fait son outil de pouvoir. La vie d’Andjelka et de sa génération est comme la fable de Pinocchio. Vous vous êtes empiffrés, vous voici devenus ânes d’abattoir. Tito mort, la saison du jeu tira à sa fin et chaque peuple n’eut plus qu’à retirer ses jetons. Pour les Serbes, majoritaires, éternels coupables du titisme, l’opération fut plus délicate que pour d’autres. D’autant plus qu’ils avaient, bons élèves, assimilé toutes les leçons d’infériorité que leurs maîtres avaient bien voulu leur inculquer. Andjelka sait trouver les mots pour expliquer ce que le mal famé « nationalisme serbe » signifiait vraiment : la libération, maladroite, partielle, inconsciente, d’une hantise collective délibérément infusée par un régime pervers. Lequel s’est peut-être servi de cette libération même pour prolonger de quelques années son agonie. Quant à l’éclatement de la Yougoslavie et aux guerres qui s’en sont suivies, il ne s’agit que d’une exploitation de cette faiblesse intérieure par la politique internationale. Il n’en reste pas moins que les rumeurs, les calomnies, les trombes de haine orchestrée qui ont plu, depuis 1991, de l’intérieur comme de l’extérieur, sur la nation serbe, si elles exaspèrent notre héroïne, demeurent un mystère qu’elle ne se hasarde pas à expliquer. Andjelka, pourtant, si elle éprouve des colères, ne juge personne. Elle aime son peuple et son temps tels qu’ils sont; elle pardonne, infiniment. S’il est une chose, toutefois, qu’elle ne pardonne pas, c’est la morgue des donneurs de leçons — domestiques plus encore qu’étrangers — qui scrutent nuit et jour les moindres écarts de sa nation. Chronique d’une époque, son Journal est aussi une typologie d’un type humain nouveau, le moralisateur « politiquement correct » animé de la haine de soi… et d’un opportunisme éthique à tout crin. Avec sa simplicité, sa franchise, sa candeur, son équité et sa puissance émotionnelle, le Journal d’une jeune ménagère serbe est une réponse splendide, bouleversante, à tous ceux qui, sans les connaître, s’emploient à juger les hommes et les nations. |