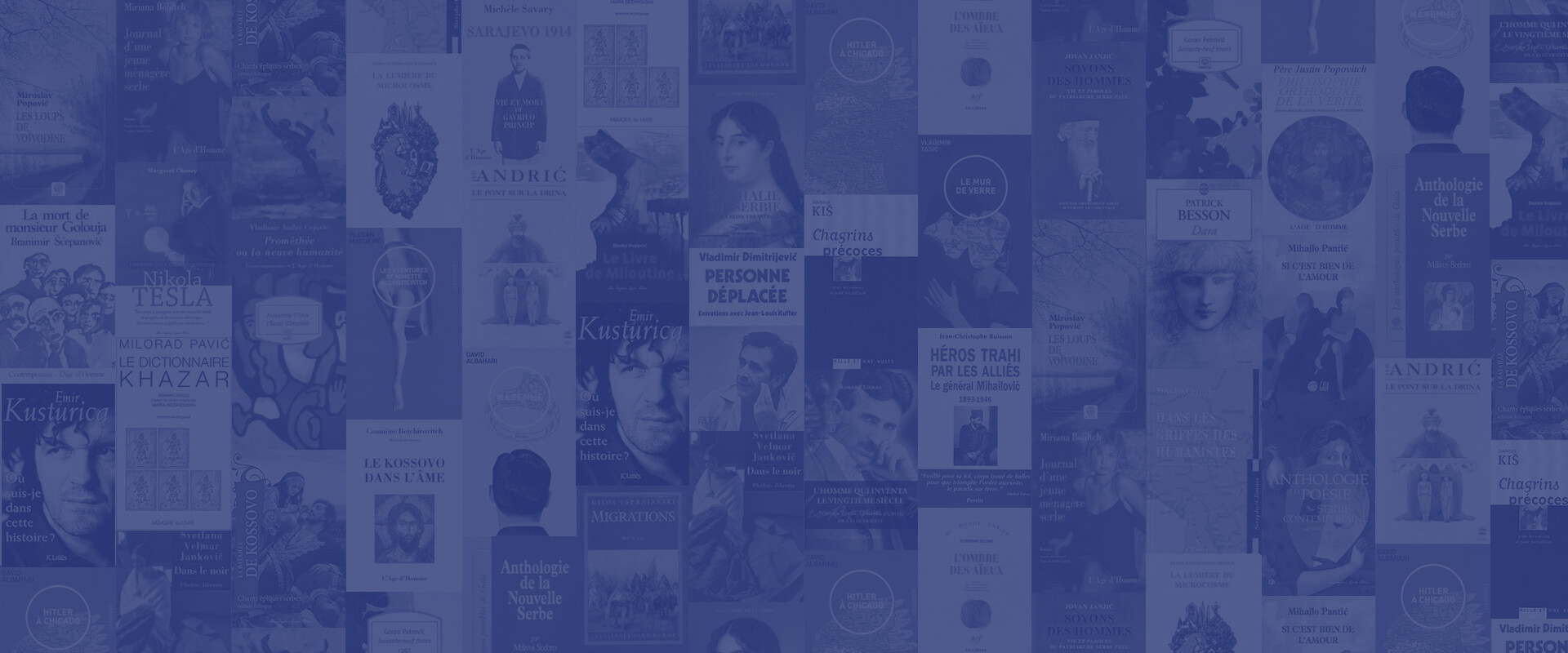Dositej Obradovic, par Michel Aubin
Dositej Obradović appartient au petit nombre d’écrivains que les Serbes désignent communément par leur seul prénom. L’usage atteste une place exceptionnelle au Panthéon national, parmi ceux que l’histoire a choisis pour repaires et pour phares.
Dans le paysage des histoires littéraires Dositej se présente comme une borne géante dressée entre deux âges. Avant lui est une ère dont les racines sont au Moyen Age, qui reste tout imprégnée de Byzance et dont la littérature s’exprime en slavon. L’ère qui le suit, contemporaine du romantisme, se choisit pour modèle la culture populaire comme seule vraiment nationale et donne à la littérature la langue des productions orales.
L’originalité de Dositej, comme aussi sa fragilité, tiennent à ce que, situé entre ces deux époques, il n’est vraiment ni l’aboutissement de la première ni l’inspirateur de la seconde. Malgré sa popularité, il ne s’impose pas comme maillon nécessaire de la continuité culturelle. C’est pourquoi Isidora Sekulić voit en lui « un esprit passif », digne seulement d’une « place d’honneur» dans les lettres, pourquoi Milovan Djilas le désigne comme « un penseur humaniste, au sens occidental du terme », resté « incompris et sans successeur, comme quelqu’un de grand et d’utile mais qui n’est pas tout à fait des nôtres ».
Et de fait, Dositej n’est pas homme de terroir. Malgré son sentiment aigu d’appartenance à la communauté serbe, il n’imaginait pas que se découvrir des spécificités étrangères aux autres peuples était se faire honneur.
L’itinéraire de ses vastes périples matérialise son itinéraire intellectuel et, de l’adolescence à l’âge mûr, le porte d’abord vers l’Orient orthodoxe avant de l’emmener jusqu’aux Lumières de France et d’Angleterre.
Il naît aux environs de 1740 dans une bourgade du Banat de Temesvar (aujourd’hui Timisora). Il a pour berceau l’un des lieux ethniquement les plus complexes de l’Europe, peuplé en majorité de Roumains mais aussi de Serbes, de Hongrois, d’Allemands, etc. Ce Banat, province hongroise sous la souveraineté des Habsbourgs de Vienne, a été reconquis sur les Turcs une trentaine d’années avant la naissance de notre auteur. Celui-ci est issu d’une famille d’artisans aisés mais, tout enfant, il demeure orphelin, de père puis de mère.
Le jeune Dimitri, comme il se prénomme alors, souffre d’une passion pour la lecture. Il dévore tous les livres dont il peut se saisir et, dans ce milieu encore médiéval en plein XVIIIe siècle, ce ne peuvent être que des livres de religion, slavons ou roumains. Les Pères du désert sont sa lecture la plus délectable. Les hagiographies lui servent de romans d’aventures, dont les anachorètes sont les héros. Il ne lui tarde que de les imiter. Aussi, peu fait pour le commerce et l’artisanat auxquels son oncle et tuteur le destine, il s’enfuit, encore adolescent, au monastère de Hopovo, dans la province voisine de Sirmie. Il s’y fait moine sous le nom de Dositej (se prononce Dositheï). Mais là son goût de l’aventure mystique cède la place à une immense soif de savoir. Son ambition d’apprendre s’accorde mal avec le séjour dans un couvent de moines incultes. Il s’enfuit une seconde fois, avec le projet de gagner un haut lieu de l’orthodoxie, Kiev, Moscou ou le Mont Athos.
Sans argent pour le long voyage qu’il médite, c’est la nécessité d’en gagner qui lui révèle sa vocation. Il se fait maître d’école dans les villages serbes de l’arrière-pays dalmate et découvre qu’il aime autant enseigner qu’apprendre. En Dalmatie, alors possession vénitienne, il demeure trois années et compose ses premiers écrits didactiques, qui circulent en manuscrits.
Grâce au pécule amassé comme maître d’école, Dositej peut réaliser son désir d’Orient byzantin. Par Corfou puis le Péloponnèse, il atteint enfin le Mont Athos. Vite déçu, il ne s’y attarde pas. Il poursuit sa route à l’Est jusqu’à Smyrne où, deux années durant, il étudie à l’école, fameuse alors dans le monde grec, du moine Iérothée Dendrin.
Chassé de Smyrne par la guerre russo-turque, il rentre en Dalmatie après un long détour par Corfou revisité et par l’Albanie où il semble jouer un rôle d’émissaire dans les préparatifs de soulèvements fomentés contre les Ottomans. A nouveau maître d’école en Dalmatie, il gagne les moyens d’aller s’installer à Vienne. Là, il donne des leçons d’italien à des enfants de marchands grecs ou serbes. Avant même d’apprendre l’allemand, il apprend le français et, dès qu’il en sait assez, l’enseigne.
Au bout de six ans passés à Vienne dans le milieu confiné de ses coreligionnaires grecs et serbes, le démon du voyage le ressaisit. Sa pérégrination le mène, cette fois, à travers l’Italie, à Chio et à Constantinople puis, sur le chemin d’un retour précipité par la peste, en Moldavie, où il s’attarde toute une année.
Alors qu’il séjourne en Moldavie, le climat politique autrichien s’est modifié. Joseph II a succédé à sa mère Marie-Thérèse à la tête de la monarchie habsbourgeoise. Il peut, sans compter avec les réticences de la vieille impératrice, régner en despote éclairé. L’une de ses premières mesures est la Patente de tolérance, qui met fin aux discriminations confessionnelles. Protestants et orthodoxes cesseront de subir les pressions du clergé catholique. Bien sûr, la mesure est accueillie avec enthousiasme par la communauté serbe d’Autriche et de Hongrie. Cette communauté, devenue foyer de culture pour tous les Serbes éparpillé à travers les Balkans, peut dès lors cesser de réagir en citadelle assiégée, s’ouvrir sur le monde extérieur. Dositej, rentré de Moldavie, peut, sans scrupule pour son identité ethnique et culturelle, rejeter l’habit de moine qui en était la manifestation. La quarantaine passée, il s’inscrit à l’université de Halle puis de Leipzig.
Dositej, en quittant l’habit, choisit de se fondre dans la foule des villes européennes, comme un Européen désormais à part entière, mais il ne rompt pas tous ses liens avec l’Eglise orthodoxe. Il ne reprend pas son prénom profane. Il reste dans tout son comportement un homme d’église, toujours heureux de se retrouver parmi ses pareils.
Difficile à documenter, le lien est pourtant étroit entre la venue au pouvoir de Joseph II et l’abandon du froc par Dositej. Sur la fin de sa vie, il confie à un correspondant qu’il doit à l’empereur son enthousiasme pour les Lumières et que, sans lui, « bien des choses ne seraient venues à l’esprit de personne ». Les termes sont certes vagues mais ces notions étrangères à l’esprit du commun des mortels, de Dositej lui-même, ne sont sans doute pas sans rapport avec les idées de sécularisation, de laïcité de la culture. Idées en effet inconcevables dans les civilisations qui n’avaient pas connu de Renaissance, comme les civilisations slaves orthodoxes.
Dositej, dès son retour de Moldavie, se met au service du joséphisme en rédigeant la première partie de Vie et aventures qui illustre la propagande anti-monastique officielle. La même année 1793, il publie sa lettre à son Aimable Haralampije. Programme d’action culturelle, la lettre débute par un panégyrique ampoulé de Joseph II, disciple de Minerve et futur libérateur des Bulgares, des Grecs et des Serbes.
Le point qui paraît aujourd’hui essentiel, dans la lettre à Haralampije, est la profession de foi en faveur de l’emploi dans la littérature de la langue vulgaire, également parlée par toutes les populations, orthodoxes, catholiques ou musulmanes, entre le Danube et l’Adriatique. Cette langue « commune» ne doit pas être la parente pauvre d’une langue littéraire savante, comme l’ont traitée quelques auteurs serbes du XVIe siècle. Elle doit se substituer à la langue savante et Dositej est le premier écrivain de sa nation à rejeter le slavon de toute son œuvre. Non qu’il méprise cette langue demeurée la langue lithurgique des Slaves orthodoxes et, en diverses variantes suivant les époques, la langue de la littérature serbe. Mais, si l’on veut laïciser la culture et rendre le livre accessible aux couches populaires, il faut, à plusieurs siècles de distance, imiter Italiens et Français, qui n’écrivent plus en latin.
Dans la communauté des Serbes de la monarchie habsbourgeoise, si longtemps blottie autour de son Eglise, l’abandon du slavon paraît non seulement sacrilège mais terriblement dangereux car susceptible de relâcher les liens traditionnels avec la Russie protectrice.
La rupture de Dositej avec la tradition littéraire n’est cependant pas totale. Il n’écrit pas le parler des masses paysannes. Il truffe sa prose et ses vers de formes slavonnes, voire russes, en concurrence sur la même page, quand ce n’est pas dans la même phrase, avec des formes authentiquement populaires. Il n’a d’ailleurs aucune prétention à la philologie, premier à reconnaître les insuffisances de sa langue et surtout de son orthographe et à s’en excuser. Il ne se donne pas pour législateur mais pour un pionnier dont « plusieurs générations» devront achever l’ouvrage. Sa langue ne se présente que comme un outil, commode et « commun », pour diffuser des idées, non comme une expression de l’âme populaire.
Cette « langue commune », il l’appelle tout uniment serbe ou encore slavo-serbe. C’est le même nom qu’il donne aux peuples qui la parlent. Le qualificatif n’a pas d’intention hégémonique à une époque où, seul dans la région, il jouissait d’une valeur ethnique étendue, si on excepte la dénomination savante d’Illyrien. Plus étonnant est le silence de Dositej, adepte de la tolérance confessionnelle, sur les auteurs catholiques qui, en Dalmatie ou en Slavonie, ont eux aussi écrit dans une langue leur permettant de se faire aisément comprendre des couches populaires. En constatant que des grammaires de la langue vulgaire n’existent pas en caractères cyrilliques, il ne reconnaît qu’implicitement qu’il en existe en alphabet latin. Mais Dositej peut-il aller plus loin et se réclamer de précédents catholiques sans effaroucher son public orthodoxe, trop instruit par une longue expérience des pièges que depuis le Contre-réforme lui tend l’Eglise romaine ? D’ailleurs, Relković ou Kacić-Miosić, dont on croit savoir qu’il a connu les œuvres, n’ont écrit en prose que leurs préfaces. Leur expression, inspirée par la poésie orale populaire, est impropre à l’usage « philosophique» que Dositej assigne à la langue.
Une fois publiés la lettre à l’Aimable Haralampije, la première partie de Vie et Aventures et Les Conseils de la saine Raison, Dositej accomplit le pèlerinage qu’il s’est promis depuis longtemps aux deux nations « les plus éclairées ». Paris le charme sans le retenir, Londres le conquiert. Il y découvre la liberté.
Dositej est non seulement le premier Serbe à chercher un modèle culturel en Europe occidentale, il est de tous les écrivains slaves du Sud de son temps, le seul à dépasser les bornes intellectuelles de l’Europe centrale.
De retour d’Angleterre, Dositej se remet au travail et publie en 1788 ses Fables, suivies de la seconde partie de Vie et Aventures, en 1793 son Recueil de divers ouvrages moraux et en 1803 une adoption de l’Ethique de Francesco Soava. Il laisse à sa mort la matière d’une sorte de supplément au Recueil de 1793, le Favori.
En dehors de Vie et Aventures, les ouvrages de Dositej sont des adaptations de contes ou nouvelles, de textes dramatiques, d’essais ou de traités de toutes sortes, allemands, anglais, français ou italiens, lardées d’interpolations, de commentaires, d’anecdotes, de souvenirs ou de réflexions personnelles. Les Fables sont des résumés en prose d’Esope, de Lessing et d’une dizaine d’autres fabulistes, prétextes à de longues moralités. Quant à ses poèmes, ils ne sont jamais que de circonstance et de forme toujours un peu gauche.
Dositej professe dans ses livres le rationalisme modéré que cultivaient les Lumières allemandes ou anglaises telles que les répandaient les loges maçonniques. Il y développe la pédagogie d’un bonheur accessible par l’instruction, laquelle mène naturellement à la vertu. Il épure sa foi chrétienne jusqu’au déisme.
Homme de son siècle par ses idées, il l’est aussi dans ses sentiments. Il est un cœur sensible, toujours prêt à verser des larmes, d’émotion, de joie ou de chagrin. Sa conviction que l’homme est bon ne relève pas seulement de la mode; elle s’accorde à son caractère tel que le décrivent ses contemporains, tel qu’il apparaît dans ses livres et dans sa correspondance : affable, débonnaire, répugnant à s’étendre sur les travers et les vices. Rien, en revanche, ne l’inspire mieux que de longuement vanter les mérites de ses amis, qui sont aussi ses « bienfaiteurs ».
Après un voyage en Livonie, où l’ont attiré les promesses d’aide du général Zorić, ancien favori de Catherine II rejeté dans une opulente défaveur, Dositej est de retour à Vienne lorsque éclate à Paris la révolution. Dans le monde germanique où il vit, les événements suscitent, de Fichte à Kant et de Herder à Klospstock, d’enthousiastes effusions. Mais la chute de Belgrade l’a plus sûrement bouleversé que celle de la Bastille, intervenue trois mois plus tôt. Elle lui laisse espérer que les Serbes vont être libérés des Turcs. L’âge d’or qu’il annonce au début de son Poème sur l’affranchissement de la Serbie est l’heureux temps à venir où Joseph II et Catherine II auront arraché un dernier pan de l’Europe à la barbarie, à la sottise, au chagrin, et non pas le fruit des révolutions de Paris.
Il est probable que le dogmatisme des hommes politiques et le rôle exorbitant des foules parisiennes ont rebuté l’esprit pragmatique et pondéré de Dositej. Toutefois, rien, dans ses œuvres ou dans ce qui nous est parvenu de sa correspondance, ne permet d’établir son sentiment avec certitude. Son chaleureux éloge du Guillaume Tell de Florian, en 1809, est-il adhésion au jacobinisme de l’œuvre ou sympathie pour un auteur que l’on comptait alors pour l’une des victimes littéraires de la Terreur ? Sans doute ni l’un ni l’autre, simplement un hommage aux similitudes des révoltes serbes et suisses, dans l’apparente ignorance du drame de Schiller.
Seule est sûre, sans être d’ailleurs explicite, sa condamnation de Bonaparte. La dénonciation d’un « nouvel Attila », d’un « conquérant avide de gloire », n’est pas ambiguë. Au demeurant, c’est au lendemain d’une occupation française, particulièrement odieuse et ruineuse pour le commerce du port, que Dositej, en 1806, quitte Trieste. Il s’y était établi quatre ans plus tôt, venu de Vienne.
Dès le début de l’Insurrection serbe, en 1804, il avait pris fait et cause pour ses compatriotes révoltés contre les Turcs. Telle était la puissance du lien que, durant près de quatre siècles, avaient entretenu l’Eglise et la tradition orale, que, sans y avoir jamais mis les pieds, sans y avoir de liens de famille ou d’amitié, il voit aussitôt dans la Serbie une «douce mère ». Non content de chanter le soulèvement dans un poème, il se fait le collecteur de fonds des Insurgés. Puis, à soixante ans passés, il va se mettre à leur service, fait office de diplomate auprès des Russes puis de conseiller auprès de Karageorges. A Belgrade, encore dévastée, il contribue à créer des écoles. Il devient ministre de l’Instruction, le premier dans la Serbie libérée, avant de mourir en 1811.
Dositej n’avait longtemps cru possible la restauration des Serbes que sous le sceptre des Habsbourgs. La réaction qui prévalut à Vienne après la mort de Joseph Il fit de lui un adversaire de l’Autriche. A sa mort, deux ans avant l’effondrement de l’Insurrection, il put croire assurée l’indépendance de la Serbie. Jamais il n’avait cessé d’être animé par un sentiment serbe que nourrissaient les traditions religieuse et populaire. Le passé serbe, c’était pour lui le règne des despotes du XVe siècle, c’étaient les stari vitezovi, les «preux de jadis» qu’interpelle la jeune fille Margita du poème populaire. Kosovo est la pierre de touche de son sentiment ethnique : il cite, dans le Favori, les vers fameux et de signification symbolique par lesquels le chant oral maudit les Serbes absents de la bataille perdue.
Vie et Aventures sont l’œuvre de Dositej demeurée la plus vivante. La première partie, parue en 1783, est à la fois le récit de son enfance et de son adolescence et un pamphlet antimonastique. La seconde, qu’il publie en 1788 sous forme de douze lettres à un ami, continue à retracer sa vie après son départ de Hopovo et jusqu’à son retour à Vienne en 1787. Dans la première partie, Dositej illustre par l’exemple de sa propre jeunesse un thème de la propagande joséphiste, la lutte contre les clergés réguliers. Dans la seconde, il manifeste ses capacités de gratitude, encourageant ainsi d’éventuels bienfaiteurs qui l’aideraient à publier ses livres.
Conçues pour édifier, Vie et Aventures ne sont pas des confessions. L’auteur évite de s’y montrer trop intimement mais, quand il apparaît, on le voit tel que ses amis l’ont décrit: aimable, gai, sensible, amateur de bonne compagnie et de bonne chère, peut-être surtout de bonne boisson, même s’il assure qu’il ne boit d’eau de vie que durant ses voyages en mer. A part son culte de l’amitié, il ne nous entretient d’aucune de ses passions, s’il lui est toutefois arrivé d’en avoir. Ses exhortations morales, ses effusions de reconnaissance, alourdies d’une rhétorique qui laisse deviner l’ancien moine prêcheur, peuvent paraître fastidieuses. Mais le récit de ses voyages à travers les Balkans ou sur la mer Egée est plein de vivacité, de charme. Ses randonnées de Temesvar à Hopovo, de Hopovo à Zagreb puis à Knin, ses expériences d’une haine confessionnelle, qui se dira plus tard nationale, son équipée en Albanie, tout cela constitue de passionnants et précieux témoignages.
Vie et Aventures sont aussi un document d’histoire littéraire, la première longue prose narrative en langue vulgaire de toutes les littératures slaves du sud. Elles créent la tradition romanesque nationale en adaptant les acquis européens. L’arrivée du narrateur à Corfou, sur une rive qui lui paraît déserte et qui se peuple durant son sommeil est, par exemple, un motif bien connu de la littérature universelle.
Dositej, qui avait une conception utilitariste de la littérature, aurait peut-être trouvé étrange qu’on traduise son livre dans la langue où, de Fénelon à Lesage et à Marmontel, de Baculard d’Arnaud à Florian, tant d’écrivains dont il s’était inspiré avaient enseigné avant lui la raison, la vertu, la tolérance et la sensibilité. Mais Dositej n’aurait-il pas pu soupçonner que les auteurs bien souvent ne sont pas lus pour ce qu’ils ont cru mettre dans leur œuvre ? Quoiqu’il en soit, n’est-il pas juste que Vie et Aventures, déjà traduites en anglais, paraissent dans la langue éclairée qu’il a passé une partie de sa vie à enseigner?
Michel Aubin
Postface de la traduction française de Vie et Aventures